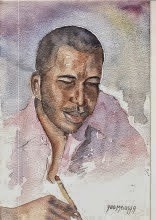Yacouba Traoré, auteur
de Gassé Galo et Bonsoir et Merci de nous suivre, deux récits qui entremêlent ses souvenirs de
journaliste télé et des enseignements sur le métier où l’on sentait affleurer le
romancier, a sauté le pas et est entré en fiction avec un premier roman intitulé
Kroh ! les Femmes ont déserté la
maison. Publié aux Editions Ceprodis en cette année 2016, c’est une
déclaration d’amour à Bobo et à ses
amazones.
A travers l’histoire de Rihanata, une adolescente contrainte
de quitter le Ghana pour venir
poursuivre ses études chez son oncle à Bobo Dioulasso, Yacouba Troré ressuscite
Bobo des années d’avant la
Révolution d’août avec ses vieux quartiers et
surtout les us et coutumes à travers les mariages et leurs cérémonials rigides,
ses griots pris en tenaille entre les valeurs du passé et les rudesses du
présent et ses adolescentes au caractère bien trempé et à la langue bien pendue.
Kroh ! est un instantané d’une ville qui tente un jeu d’équilibriste pour rester dans le vieux monde tandis que le nouveau l’aspire avant une grande force. Ce livre est un Polaroïd de Sya dont les couleurs se sont un peu estompées avec le temps mais dont on devine l’architecture dans les contours sépia.
Kroh ! est un instantané d’une ville qui tente un jeu d’équilibriste pour rester dans le vieux monde tandis que le nouveau l’aspire avant une grande force. Ce livre est un Polaroïd de Sya dont les couleurs se sont un peu estompées avec le temps mais dont on devine l’architecture dans les contours sépia.
Toutefois, bien que le roman s’ancre dans un Bobo des années
70 (nous le croyons), l’auteur rompt avec le réalisme du roman burkinabè et
construit un univers panthéiste où les êtres et les choses sont des personnages
qui interagissent et communiquent. Le réalisme magique. C’est bien une tourterelle qui annonce
l’arrivée de Rihanata, ce sont des silures sacrées qui dressent un cordon de
sécurité autour d’un personnage agressé. C’est aussi la lune qui patrouille la
nuit et décide de la sanction à infliger à l’indélicat et désigne ses bourreaux !
Ici un vent vicieux folâtre dans les pagnes des dames et là, le soleil provocateur
envoie des flèches sur les crânes dégarnis. Ce roman est un immense poème païen
de l’unicité du monde.
Mais le vaste chant au monde n’empêche pas le narrateur de
promener un regard plein d’ironie sur les hommes. L’auteur a l’art du portrait
incisif et caricatural. Il croque une galerie de personnages inoubliables avec
un sens du détail qui détonne et du mot qui fait mouche. Que ce soit le
taxi, l’inénarrable griot ou le délégué du Lycée Ouezzin, il naît sous sa
plume des personnages désopilants.
Il faut dire que l’auteur travaille bien sa prose. Il quête
la métaphore, recherche la phrase ample et chatoyante, passe les mots l’étamine avant de les coucher
sur la feuille comme des pépites. C’est un exercice de style qui s’apparente à
de l’orpaillage et qui montre que l’auteur est un redoutable bretteur de la
langue mais qui, à notre sens, ne sert pas toujours le récit. Ainsi la métaphore filée sur le zébu agonisant pour évoquer l'entrée du train Gazelle en gare qui ouvre le roman et dont la saisie est difficile, n’est pas le meilleur
moyen de faire franchir le seuil d’un roman à un lecteur. Serait-ce une coquetterie du journaliste télé qui tient à
montrer que contrairement à l’idée répandue, les journalistes du petit écran sont
capables de se départir du style télégraphique de ce média pour être de
vrais littérateurs. Certainement !
Un roman anthropophage
culturel
Ce roman révèle que l’auteur est un grand lecteur doublé d’un
mélomane éclectique. Michel Foucault disait que la littérature commence
quand le livre n’est plus l’espace où la parole prend figure, mais le lieu où
les livres sont tous repris et consumés. Ce roman est un palimpseste où
s’inscrivent les grands musiciens des années 70 de la chanson française, de la
pop et de la rumba congolaise ainsi que des romans de la littérature monde.
Kalala, Bad Co, Malko comme surnoms de certains personnages et des comparaisons
avec Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Tina Turner montre un auteur mélomane. En outre, ce
roman oscille entre le roman à thèse avec les discussions entre l’héroïne et sa
tante ou avec Bakoroba, le chef de Dioulassoba. De longs dialogues mâtinés de
philosophie et de théosophie font penser
aux dialogues fleuves de l’Aventure ambiguë de Cheick Hamidou Kane et à La Condition
humaine de Malraux. Ahmadou Kourouma aussi pointe du nez avec des injures en
langue et des malinkismes. Même
Gérard de Villiers se retrouve dans la description de la plastique des femmes.
Ce sont d’ailleurs les femmes qui sont les héroïnes de ce roman. Si elles
ont déserté la maison, c’est parce qu’elles ne veulent plus être confinées au harem
d’un polygame, elles prennent les rênes de leur destin. Comme Rihanata,
elles refusent d’être des objets entre les mains des hommes, soient-ils leurs
géniteurs, elles n’offrent plus leur hymen à l’époux et elles poussent jusqu’à
l’absurde les règles pour montrer leur inadéquation avec l’époque.
Kroh est aussi un hymne à
l’interculturalité et à la multicuturalité. En ce moment où les politiques de
décentralisation mal comprises ont exacerbé les replis identitaires et semer
les graines de la division, mettre en scène une famille Nacanabo vivant à Dioulassoba et dont l’une des filles
se bat pour sauvegarder le Dafra et ses silures sacrés n’est pas gratuit. C’est une fiction pour dire qu’il n’y a pas
d’étrangers à Bobo, juste des amis qui ne se sont pas encore retrouvés. Et ce
roman se verrait bien comme le lieu de retrouvailles des amis et des fils de
Bobo.
Voilà enfin un premier roman qui ne tombe pas dans le piège courant
des primipares de vouloir tout embrasser, il pêche, s’il
fallait absolument lui trouver un défaut, par parcimonie : il s’attache
trop à Rihanata et à son sillage immédiat de sorte que le contexte historique
ou politique n’est pas développé. Ici on sent que l’auteur est un journaliste
et reporter télé, son narrateur porte une camera à l’épaule et filme le
personnage principal. Là où elle n’est pas, le narrateur ne s'y trouve pas non plus.
Pour rester dans le langage de l’image, on dira que le plan général est l’image manquante de
ce premier roman.
Pourtant le lecteur aurait aimé que le narrateur plantât Rihanata quelquefois et allât se perdre dans les tréfonds de la ville pour nous faire sentir son haleine faite de l’encens envoûtant de ses dames, de l’odeur enivrant de la bière de mil des gargotes de Bolmakoté, les effluves du thé à la mente des grins et de maints autres parfums qui lui donne sa fragrance unique tout à la fois de village éternel et de cité cosmopolite.
Gageons
que le prochain roman le fera car il est évident que Yacouba Traoré est tombé
en littérature et il n’est pas près d’en sortir.Pour le grand bonheur des
lecteurs. En attendant, immergez-vous dans Kroh,…
pour sentir pulser le souffle enivrant
de Sya la Belle et suivre les
pérégrinations de Rihanata dans la cité des silures, une rebelle sans cause qui
trouvera au Pays de ses pères le sens de l’engagement citoyen et le sens
de sa vie.