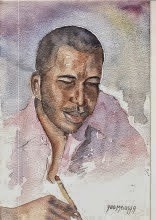Tout le mois de décembre 2013, l’Institut français de Ouagaougou a accueilli une expo de l’artiste plasticien Hyacinthe Ouattara. Une soixantaine de tableaux après trois ans de labeur. De 2011 à 2013, il a dessiné et peint des scènes de personnages mi-hommes, mi-bêtes. Une variation sur le même thème qui donne à voir un univers cocasse et tragique.
Devant les œuvres de Hyacinthe Ouattara, le public est surpris : les dessins et les peintures de Hyacinthe semblent avoir été faits par une main d’enfant. D’apparence facile mais en réalité c’est exercice difficile pour l’artiste que celui de retrouver le tracé enfantin. Pablo Picasso, un peintre majeur du dernier siècle dont le talent fut précoce disait « A 8 ans, j’étais Raphaël. J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ».
Heureux donc, Hyacinthe Ouattara qui, il y a trois ans, en laissant son crayon courir librement sur une feuille à retrouver le gribouillis de l’enfance. Ses personnages sont des ébauches mi-hommes, mi-bêtes et ces formes malhabiles ont l’inachevé, la naïveté et la gaucherie du dessin d’enfant.
Sans verser dans la psychanalyse à deux sous, on sait que le dessin d’enfant est une photographie de son monde intérieur, de ses angoisses et ses rêves. Les créatures de Hyacinthe aussi racontent ses états d’âme, elles sont le relevé de la météo intérieure de l’artiste.
Visage fondus, yeux écarquillés, corps amputés, difformes, déformés, ces personnages tératologiques sont fidèles à la fonction que Paul Klee affecte à la peinture, à savoir que « l’art ne reproduit pas le visible. Il rend visible ». En effet, ces œuvres oscillant entre l’art brut et le la peinture primitive sont un opéra fabuleux, un théâtre de silhouettes zoomorphes qui rejouent, pour qui sait voir, le drame de l’Humain entre joie, rires, angoisse, solitude, violence.
Cette expo réunit des œuvres déjà vues auparavant et des inédits. La scénographie inspirée de l’architecture de l’arène transforme le spectateur en un taureau et cette balade picturale se mue en corrida ! Le choix de ne pas mettre dans l’ordre les séries de tableau mais de les disséminer dans un rangement aléatoire oblige le spectateur à revenir en arrière pour s’assurer s’il n’a pas déjà vu un semblable tableau ailleurs.
Un va-et-vient incessant qui s’apparente aux mouvements taurins dans l’arène. Parfois des pages d’un roman d’aventure arrachées et collées sur des toiles présentent des fragments de textes qui immobilisent le regard et figent le spectateur dans une pause lecture. Ailleurs, il est pris dans un tourbillon de formes, de couleurs, de visages étranges, d’yeux qui le scrutent. Le jaugent. Le jugent.
Entre malaise et sidération, le visiteur a le saisissement d’être vus, par les yeux moqueurs, rieurs, interrogateurs ou angoissés de ces êtres surgis des toiles. Certains personnages font foule et saturent la toile donnant une impression d’étouffement. D’autres, seuls ou en petits groupes émergent d’un fond bleu, gris, vert suggèrent des scènes de vie empreintes de légèreté taquine et mâtiné d’humour.
Quelques toiles toutefois secouent par leur extrême violence. Comme ce personnage noir sur un fond rouge sang. Heureusement cette violence rouge et noir est tempérée par deux toiles jaunes qui l’encadrent. De cette tournée dans l’arène, le spectateur en ressort tout bouleversé.
Cette exposition donne à voir la nouvelle orientation de la peinture de Hyacinthe Ouattara qui se fait plus intuitive, plus subjective, plus introspective. En somme, une peinture expressionniste. Un retour vers la peinture moderne, c’est-à-dire la toile, le cadre et la peinture d’un artiste qui avait exploré les sentiers de l’art contemporain en usant d’autres matériaux et d’autres supports.
En effet, sur le plan formel, ces œuvres s’inscrivent dans un courant fort classique, l’expressionnisme, et le texte dans la toile remonte aux natures mortes de Braque. Mais sur le plan personnel, c’est une rupture car l’artiste délaisse les sujets généraux et sociétaux pour se recentrer sur son jardin intérieur. Son art gagne ainsi en sincérité et en authenticité.
En peignant son univers intérieur, il réussit à parler de notre monde avec un regard singulier. C’est en creusant sa particularité que l’on tend à l’universel, disait André Gide. Et effectivement les personnages zoomorphes de Hyacinthe Ouattara évoquent le théâtre de notre vie, tendu entre le comique et le tragique.
Devant les œuvres de Hyacinthe Ouattara, le public est surpris : les dessins et les peintures de Hyacinthe semblent avoir été faits par une main d’enfant. D’apparence facile mais en réalité c’est exercice difficile pour l’artiste que celui de retrouver le tracé enfantin. Pablo Picasso, un peintre majeur du dernier siècle dont le talent fut précoce disait « A 8 ans, j’étais Raphaël. J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ».
Heureux donc, Hyacinthe Ouattara qui, il y a trois ans, en laissant son crayon courir librement sur une feuille à retrouver le gribouillis de l’enfance. Ses personnages sont des ébauches mi-hommes, mi-bêtes et ces formes malhabiles ont l’inachevé, la naïveté et la gaucherie du dessin d’enfant.
Sans verser dans la psychanalyse à deux sous, on sait que le dessin d’enfant est une photographie de son monde intérieur, de ses angoisses et ses rêves. Les créatures de Hyacinthe aussi racontent ses états d’âme, elles sont le relevé de la météo intérieure de l’artiste.
Visage fondus, yeux écarquillés, corps amputés, difformes, déformés, ces personnages tératologiques sont fidèles à la fonction que Paul Klee affecte à la peinture, à savoir que « l’art ne reproduit pas le visible. Il rend visible ». En effet, ces œuvres oscillant entre l’art brut et le la peinture primitive sont un opéra fabuleux, un théâtre de silhouettes zoomorphes qui rejouent, pour qui sait voir, le drame de l’Humain entre joie, rires, angoisse, solitude, violence.
Cette expo réunit des œuvres déjà vues auparavant et des inédits. La scénographie inspirée de l’architecture de l’arène transforme le spectateur en un taureau et cette balade picturale se mue en corrida ! Le choix de ne pas mettre dans l’ordre les séries de tableau mais de les disséminer dans un rangement aléatoire oblige le spectateur à revenir en arrière pour s’assurer s’il n’a pas déjà vu un semblable tableau ailleurs.
Un va-et-vient incessant qui s’apparente aux mouvements taurins dans l’arène. Parfois des pages d’un roman d’aventure arrachées et collées sur des toiles présentent des fragments de textes qui immobilisent le regard et figent le spectateur dans une pause lecture. Ailleurs, il est pris dans un tourbillon de formes, de couleurs, de visages étranges, d’yeux qui le scrutent. Le jaugent. Le jugent.
Entre malaise et sidération, le visiteur a le saisissement d’être vus, par les yeux moqueurs, rieurs, interrogateurs ou angoissés de ces êtres surgis des toiles. Certains personnages font foule et saturent la toile donnant une impression d’étouffement. D’autres, seuls ou en petits groupes émergent d’un fond bleu, gris, vert suggèrent des scènes de vie empreintes de légèreté taquine et mâtiné d’humour.
Quelques toiles toutefois secouent par leur extrême violence. Comme ce personnage noir sur un fond rouge sang. Heureusement cette violence rouge et noir est tempérée par deux toiles jaunes qui l’encadrent. De cette tournée dans l’arène, le spectateur en ressort tout bouleversé.
Cette exposition donne à voir la nouvelle orientation de la peinture de Hyacinthe Ouattara qui se fait plus intuitive, plus subjective, plus introspective. En somme, une peinture expressionniste. Un retour vers la peinture moderne, c’est-à-dire la toile, le cadre et la peinture d’un artiste qui avait exploré les sentiers de l’art contemporain en usant d’autres matériaux et d’autres supports.
En effet, sur le plan formel, ces œuvres s’inscrivent dans un courant fort classique, l’expressionnisme, et le texte dans la toile remonte aux natures mortes de Braque. Mais sur le plan personnel, c’est une rupture car l’artiste délaisse les sujets généraux et sociétaux pour se recentrer sur son jardin intérieur. Son art gagne ainsi en sincérité et en authenticité.
En peignant son univers intérieur, il réussit à parler de notre monde avec un regard singulier. C’est en creusant sa particularité que l’on tend à l’universel, disait André Gide. Et effectivement les personnages zoomorphes de Hyacinthe Ouattara évoquent le théâtre de notre vie, tendu entre le comique et le tragique.